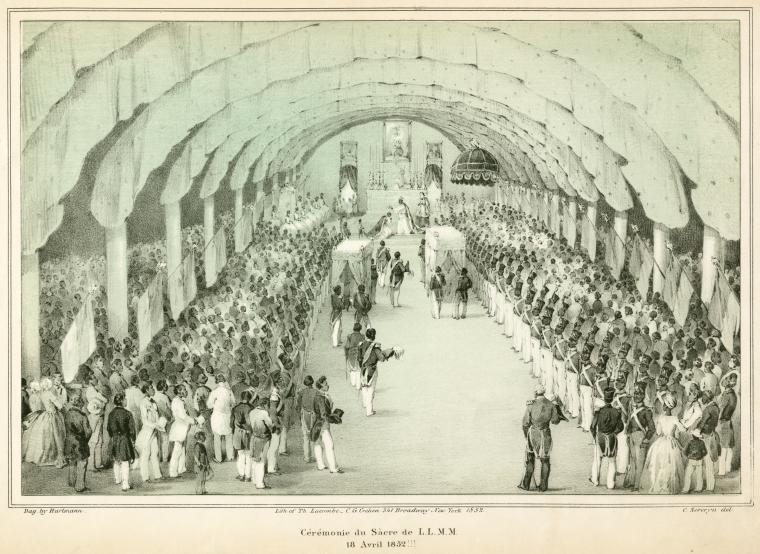

Santana ne voyait plus ni intrigues ni obstacles autour de lui, et la triple investiture que venaient de lui donner la victoire, la reconnaissance des municipalités et les acclamations de l’armée légitimaient certes, le pouvoir dans ses mains. Il n’eut cependant rien de plus pressé que de s’en démettre, n’acceptant que le rang de généralissime ; et fit porter à la présidence son ami Baez, que le désistement de Santana suffisait d’ailleurs à désigner au choix de l’opinion.
Don Buenaventura Baez est un des plus riches propriétaires du pays, est né à Azua, petite ville où végéta durant quelques années un modeste greffier d’ayuntamiento appelé Fernand Cortès. Baez est un homme d’environ trente-huit ans, petit et mince, excellent cavalier, très instruit ; grand connaisseur des hommes, actif comme la poudre, discret comme la tombe, brave comme une épée, et exerçant à certain degré autour de lui ce magnétisme de dévouement qui rayonne autour du héros seybano. Il a cinq frères, dont deux élevés en France, cinq gaillards passablement débraillés d’allures et de toilette, et qui sont la terreur de tout ennemi du nom des Baez.
Dans la dernière crise, lorsque don Buenaventura les voyait rôder, sournoisement autour de lui, il savait, sans avoir besoin de s’en enquérir, qu’un péril personnel le menaçait ; mais il savait aussi qu’il n’avait pas à s’en occuper.
Le père de Baez avait pris une part active à l’insurrection de 1808, et tels sont les regrets laissés dans le pays par la domination française, que ce souvenir jeta comme une ombre de défaveur sur les débuts politiques du futur président dominicain. Nul n’a montré cependant pour la France des sympathies plus ardentes et plus soutenues. C’est lui que nous avons vu prendre, en 1844, l’initiative des ouvertures faites à MM. Barrot et Levasseur, lui qu’on retrouve jusqu’au bout dans ce singulier combat d’une petite nation qui se donne et d’une grande nation qui l’aime et ne veut pas l’accepter. Baez a un profond attachement pour Santana, qui n’a de son côté, qu’une préoccupation : faire valoir Baez.

Buenaventura Baez, président de la République dominicaine
Sous l’influence combinée de ces deux hommes, la petite république, qui s’était jusque-là retranchée dans la défensive, comme pour bien prouver qu’elle voulait l’indépendance et non la domination, a pris une attitude nouvelle. Devant les projets incendiaires de Soulouque, les Dominicains se sont enfin décidés à repousser l’agression par l’agression. Les haïtiens ne pourront pas dire d’ailleurs que Baez les prend en traître. Il leur adressait, dès la fin de 1849 la proclamation suivante, et cet échantillon du style diplomatique des Dominicains tranche, par parenthèse, d’une façon assez piquante sur les tendres appels que faisait Soulouque à ses « frères et concitoyens de l’Est » en allant promener chez eux l’assassinat et l’incendie.
Lettre de Buenaventura Baez, Président de la République Dominicaine, aux Haïtiens
« Haïtiens, le nouveau président de la république Dominicaine s’adresse à vous, au nom de ses concitoyens, dans leur intérêt et dans le vôtre.
« Haïtiens, il y a bientôt six ans qu’en nous séparant de vous, nous avons repris notre indépendance, et, malgré les assurances que l’on vous a données dans des proclamations trompeuses, vous devez être convaincus aujourd’hui que cette séparation est éternelle.
« En restant chacun libres sous nos différentes bannière nous pouvions vivre en bons voisins. Nous vous y avons conviés en vous proposant une paix que réclamaient votre vie, votre repos, vos intérêts mais ceux qui vous gouvernent, ont préféré vous arracher à vos maisons, à vos cultures, pour vous charger d’armes, de munitions, et, après vous avoir fusillés pour vous forcer à venir nous combattre, ils vous ont envoyés vous faire tuer à Azua, à Saint-Yague, à las Carreras. Rappelez-vous vos souffrances dans la dernière campagne que notre brave Santana a terminée d’une manière si glorieuse, et voyez quelle confiance vous pouvez avoir dans les hommes qui vous ont représenté votre cruelle défaite comme une victoire.
« Dans l’espoir que vous imiteriez un jour notre modération, nous ne vous avons jamais attaqués chez vous, nous nous sommes bornés à repousser vos agressions ; mais toute patience s’épuise, et, puisque, vous n’avez pas voulu la paix, supportez donc à votre tour sur vos propriétés, sur vos personnes, tout le poids de la guerre.
« Quand nous voudrons vous attaquer, nous connaissons parfaitement nos avantages et votre faiblesse. Par mer et sur vos rivages, nous pouvons vous faire autant de mal qu’il nous conviendra. Tandis que nous n’avons sur nos côtes que trois villes, Santo-Domingo, Puerto Plata et Samana, villes que leurs forts et leurs murailles mettent hors d’atteinte, vos côtes au contraire sont couvertes d’innombrables habitations bourgs, villages, villes bâties en bois, sans défense et offrant au pillage et à l’incendie une proie vraiment trop facile. Anse-à-Pitre, Sale-Trou, Aquin, les Cayes peuvent vous dire déjà ce que nous saurons faire, et peut-être êtes-vous près de voir se réaliser ce que vous avez annoncé tant de fois sans l’accomplir : vos villes vont disparaître, et la nation ira se réfugier dans les bois.
« Haïtiens, notre flotte bien armée, bien équipée, bien commandée, avec de nombreuses troupes de débarquement, est sortie pour aller piller vos côtes et intercepter votre marine ; veillez donc de nuit et de jour ; veillez au nord, l’ouest, au sud, chassez vos femmes et vos enfants dans les mornes, abandonnez vos cultures pour faire sentinelle l’arme au bras sur les rochers parie vent et la pluie, et vous trouverez au retour vos cases brûlées. Puisque vous vous laissez imposer la guerre par ceux qui vous gouvernent, il est temps que vous sachiez ce que coûte la guerre.
« Et pourtant vous ne le savez que trop déjà. C’est à la guerre que vous devez l’odieux monopole qui vous épuise, les réquisitions de toute nature, le service militaire exagéré avec les fusillades de Las Matas ; c’est à cause de la guerre que vos enfants souffrent, que vos femmes pleurent, et qu’il n’y a plus nul bien-être chez vous ; c’est par la guerre enfin que tant de malheureux parmi vous sont venus, comme si vous n’aviez pas assez de terrain, chercher un tombeau sur notre territoire.
« Voyez maintenant ce que vous aurez à souffrir du nouveau genre de guerre que nous avons commencé, puisque notre flotte, en interceptant vos caboteurs ajoutera à la misère qui vous dévore la ruine du peu de commerce que le monopole vous avait laisse Si, pour en tirer vengeance, vos gouvernants veulent vous pousser à une nouvelle expédition par terre, dites-leur qu’aujourd’hui, chez nous, administrateurs et administrés nous ne formons plus qu’une seule famille, unis, dans la résolution, non-seulement de nous défende à toute outrance, mais encore d’attaquer l’ennemi ; recommandez aussi à vos gouvernants de prendre bien garde d’éveiller le lion du Seybo.
« Haïtiens, nous pouvions vivre pacifiquement chacun dans nos frontières, échangeant, à notre avantage commun, nos bestiaux et nos tabacs contre vos cafés ; nous pouvions naviguer paisiblement, sans crainte, sur les mers si belles que Dieu nous a données ; ceux qui vous gouvernent n’ont pas voulu nous laisser jouir de ces avantages, et ils ont voulu la guerre ; eh bien ! que les maux de la guerre retombent sur leur tête et sur vous, qui ne savez, pas les contraindre à faire la paix.
« Santo-Domingo, le 16 novembre 1849.
« BUIENAVENTURA BAEZ » « Par le président, Le ministre de la guerre,« J. E. AYBAR. »
C’est clair et net, et c’est surtout vrai.
Les côtes haïtiennes sont vulnérables par une infinité de points, et Soulouque en aurait déjà fait l’expérience, si les consuls, dans l’espoir de plus en plus chimérique d’amener le chef noir à conclure la paix, ne retenaient depuis quelque temps les deux flottilles dans leurs ports respectifs.
Non, le véritable danger n’est pas pour les Dominicains dans une invasion, il est dans le fait seul de la guerre. Sans parler des inévitables ravages que la guerre entraîne pour un pays dont la véritable frontière, celle qu’il importe le plus de ne pas dégarnir, ne commence qu’assez avant dans l’intérieur, l’obligation de tenir sur pied la portion la plus active de sa population agricole suffirait à réduire cette petite nation aux abois, car l’agriculture est son unique ressource aujourd’hui que le débouché haïtien est fermé à ses bestiaux.
Le service militaire est bien réparti de façon à ce que la moitié seule de l’armée soit sous les armes en temps ordinaire ; mais à tout bout de champ survient la nécessité d’une levée en masse, et la plupart des cultivateurs, fatigués de perdre leurs récoltes qu’ils devaient, au dernier moment, abandonner sur pied, ont fini par laisser leurs champs en friche. Dès 1847, la république dominicaine avait peine à nourrir ses soldats ; les coupes d’acajou étaient devenues sont unique moyen d’échange avec le dehors ; les marchés d’Europe étaient encombrés de ce bois, l’encombrement avait produit l’avilissement des prix, et les négociants invitaient les coupeurs à suspendre leurs envois, qui ne couvraient même plus le fret. Depuis lors, c’est en argent comptant que les Dominicains sont réduits à payer les denrées, les armes, les munitions qu’ils tirent des États-Unis, et le peu de numéraire que la domination de Boyer n’avait pas mis en fuite est à la veille de disparaître entièrement. Les Dominicains, en un mot, sont aujourd’hui aussi misérables que la population de l’ouest, avec le sentiment de leur misère, le regret de ce qu’ils pourraient être, et la prévision d’un sinistre avenir en plus.
Une offensive heureuse ne changerait rien à cette situation. La population haïtienne est trop apathique, trop imprévoyante, trop identifiée avec son propre dénuement, pour que l’incendie de ses maisons qu’elle laisse elle-même tomber en ruines, la dévastation de ses terres qu’elle condamne elle-même à la stérilité, suffisent, le cas échéant, soit à la réduire à discrétion, soit à la soulever contre l’entêtement de Soulouque. Sa répugnance pour cette guerre se traduirait, à chaque descente de l’ennemi, par la fuite, et le lendemain tout serait à recommencer car les Dominicains sont trop peu nombreux, et ils ont d’ailleurs chez eux une ligne trop étendue à garder, pour songer à s’établir sur les points où porteraient leurs razzias.
Ce qu’il leur faut, encore une fois, c’est la paix, une paix complète et durable, qui, en les dispensant d’armements ruineux, en leur permettant de reprendre leurs travaux, en offrant de sérieuses garanties à l’immigration blanche qu’ils appellent à genoux, ferait de leur misérable pays ce que Dieu en avait fait : la plus riche contrée des deux mondes.
Or cette paix, ils ne l’obtiendront jamais de la libre volonté de Soulouque, qui jure de plus belle par l’âme de sa mère d’exterminer « les rebelles de l’est comme cochons marrons, » et qui, pendant que les consuls s’époumonent à lui imposer soit un traité de paix définitif, soit une trêve de dix années, poursuit avec un flegme imperturbable ses armements. Bien que les magasins de l’état, regorgent de vivres et de munitions, il en arrive tous les jours des États-Unis, et voilà plusieurs mois qu’on expédie sans discontinuer des poudres à la frontière. L’enrôlement forcé, auquel n’échappent pas même les enfants de quinze ans se poursuit avec une rigueur excessive.
La réponse de Soulouque
Soulouque peut aujourd’hui mettre sur pied environ trente mille hommes contre sept à huit mille, qui forment le ban et l’arrière-ban de la population valide de l’Est, et il ne paraît pas vouloir s’arrêter là. Les chambres ont silencieusement voté une addition de près de trois millions de francs au budget de1851, qui se trouve ainsi augmenté d’un tiers. L’empereur s’est fait en outre donner la faculté d’ouvrir des crédits supplémentaires à peu près illimités pour les besoins imprévus. Dans l’intervalle, et pour nous servir de l’expression échappée au secrétaire intime de sa majesté, on ne s’occupait ni ne se préoccupait de la note des consuls. Après avoir épuisé tous les moyens dilatoires de la diplomatie haïtienne, — la plus terrible et la plus harassante des diplomaties, — Soulouque s’est engagé, il est vrai, à donner une réponse catégorique, et il a convoqué extraordinairement les deux chambres pour leur déférer la question ; mais le rôle de cet étrange parlement est connu d’avance, et de peur que les sénateurs ou députés ne se méprennent sur ce qu’ils doivent penser et dire, sa majesté, selon son habitude, a soin de leur donner d’avance le diapason.
Tous les dimanches, à la parade de la garde et dans chacune de ses réceptions officielles, l’empereur et roi fait naître des occasions de rappeler que la constitution, cette même constitution qu’il a trouée douze ou quinze cents fois à travers les poitrines de ses fidèles sujets, l’oblige à maintenir l’intégrité du territoire. Quant à la trêve de dix ans, sa majesté s’écrie que l’Europe entière en profiterait pour se précipiter dans l’île par la porte que les Dominicains ouvrent à l’immigration blanche. Ainsi c’est bien décidément la barbarie, qui jette le gant à la civilisation. Les chambres ont dû se tenir pour averties, d’autant plus que des exécutions nouvelles sont venues, dans l’intervalle, raviver leur sollicitude pour l’harmonie des pouvoirs, à l’heure qu’il est, Soulouque déclare probablement aux consuls de France et d’Angleterre et à l’agent spécial des États-Unis « que l’opinion du pays ; représenté par ses organes légitimes, lui ordonne de faire rentrer département de l’est dans le giron de l’empire. »
Il n’y a pas de doute que la présence d’une station navale suffirait à empêcher le départ de l’expédition ; mais devons-nous nous résigner à faire indéfiniment sentinelle autour de cette grotesque majesté ? Ne peut-on pas prévoir surtout des circonstances qui appelleraient brusquement ailleurs les bâtiments des trois puissances médiatrices, circonstances dont Soulouque se hâterait de profiter pour tomber en vingt-quatre heures sur les malheureux Dominicains ? Or, cette dernière éventualité suffirait pour perpétuer chez eux les angoisses de l’incertitude, c’est-à-dire tous les inconvénients de leur intolérable situation.
Une seule crainte pourrait désormais avoir définitivement raison de l’obstination du vieil empereur : c’est la perspective d’aller se heurter dans l’Est contre l’intérêt moral, l’intérêt politique ou l’intérêt territorial d’une grande puissance. L’intervention directe d’une grande puissante sous forme de protectorat d’occupation, partielle ou d’annexion pure et simple, n’est donc plus, à l’heure qu’il est, pour les Dominicains, une question de progrès : c’est une question de vie ou de mort.
Gustave d’Alaux

Caricature de Maxime Raybaud dit Gustave d’Alaux, consul général de France à Haïti
« L’Empereur Soulouque et son empire »
Paru dans la Revue des Deux Mondes en 1851
Lire notre article : https://lepetitjournal.com/haiti/actualites/histoire-origine-des-partis-haitiens-78605
Lundi 19 février 2018

